C’est une annonce qui résonne comme un coup de tonnerre dans l’enceinte feutrée de l’Assemblée générale des Nations Unies : la France, accompagnée de plusieurs autres pays européens et arabes, a officiellement reconnu l’État de Palestine lors d’un sommet diplomatique conjointement organisé avec l’Arabie saoudite. Un geste hautement symbolique, et potentiellement structurant, dans un conflit israélo-palestinien enlisé depuis des décennies.
Un cadre solennel pour une décision attendue
Le sommet, organisé en marge de l’Assemblée générale, a rassemblé une quarantaine de chefs d’État et de diplomates de haut rang. La déclaration finale a été lue par le président français Emmanuel Macron, aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.
« Il est temps que la communauté internationale agisse de manière cohérente avec ses principes. Reconnaître l’État de Palestine, c’est affirmer le droit des peuples à l’autodétermination et rouvrir la voie d’un dialogue fondé sur l’égalité », a déclaré le président Macron, visiblement ému, dans un discours qui marquera sans doute son second mandat.
La France rejoint ainsi plus de 140 États qui reconnaissent officiellement la Palestine, dont la majorité sont issus du Sud global. Mais le poids politique, économique et diplomatique de Paris confère à cette reconnaissance une résonance toute particulière en Europe de l’Ouest, où peu de grandes puissances avaient jusqu’alors franchi ce pas.
Un geste politique, mais quelles conséquences concrètes ?
À Ramallah, la nouvelle a été accueillie avec des cris de joie et des scènes de liesse. « C’est une victoire morale et diplomatique. Nous saluons le courage de la France et de ses partenaires », a réagi Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne.
Mais dans les faits, cette reconnaissance changera-t-elle le quotidien des Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza ou de Jérusalem-Est ? Rien n’est moins sûr.
Pour Yoav Lellouche, chercheur israélien en relations internationales, basé à Tel Aviv, « la reconnaissance est un acte fort symboliquement, mais sans mécanisme d’application sur le terrain, elle risque de rester lettre morte. Pire encore, elle pourrait renforcer les positions les plus radicales des deux camps ».
Du côté du gouvernement israélien, la réaction ne s’est pas fait attendre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a condamné une décision qu’il qualifie de « grave erreur stratégique ». « Elle envoie un message erroné : récompenser l’intransigeance palestinienne et affaiblir la sécurité d’Israël », a-t-il déclaré dans un communiqué.
Une pression internationale renouvelée
Depuis la reprise du cycle de violence en 2023, la pression internationale pour une relance du processus de paix s’est intensifiée. Mais les négociations directes sont au point mort depuis près d’une décennie, et la colonisation israélienne continue de grignoter la Cisjordanie.
« Il fallait un électrochoc, et c’est ce que représente cette reconnaissance collective », estime Nadia Karam, diplomate libanaise et ancienne négociatrice à l’ONU. « Cela redonne une légitimité internationale au projet de deux États, qui semblait condamné à l’oubli. »
L’initiative franco-saoudienne vise également à isoler les acteurs non coopératifs, tout en encourageant une reprise des discussions sous l’égide d’un nouveau format. Certains parlent déjà d’un « Quartet élargi », incluant non seulement les États-Unis, l’UE, la Russie et l’ONU, mais aussi des puissances régionales comme l’Égypte, la Jordanie et désormais l’Arabie saoudite.
Un nouveau chapitre ou une parenthèse ?
Reste à savoir si cet élan diplomatique se traduira par des avancées concrètes sur le terrain : levée progressive du blocus sur Gaza, gel des colonies israéliennes, élections palestiniennes, garanties de sécurité pour Israël, etc.
L’histoire du conflit israélo-palestinien est jalonnée de déclarations ambitieuses restées sans lendemain. Mais pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d’urgence semble partagé.
« Ce n’est pas la reconnaissance qui fera la paix, mais elle peut la rendre possible », glisse une source diplomatique française.
Et si le vrai tournant résidait là : dans la réaffirmation, au plus haut niveau, que la paix n’est pas une utopie, mais une responsabilité commune ?


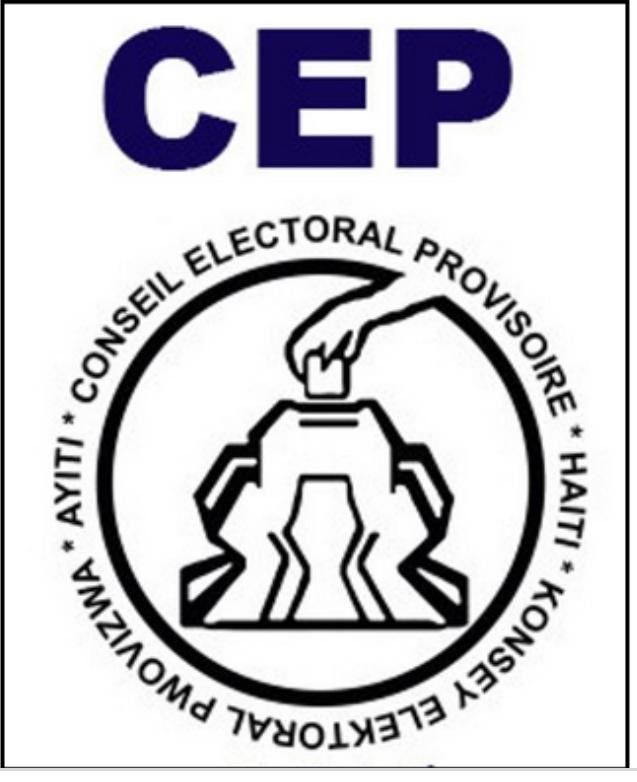


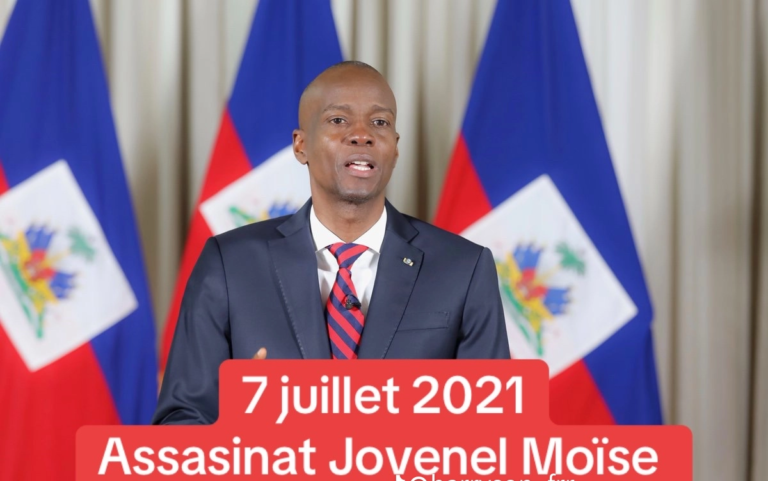
Heads up, if you’re trying to get into Okebet168, the login at okebet168login.com looks good. Just make sure you’re using your correct details, yeah? Happy gaming! Login here: okebet168login
Alright, may88bet is on my radar. Saw a couple ads online. Anyone placing bets there? What’s the vibe like? Any good promotions going on?
Heard about 160bet from a buddy. Threw a few bucks on it and actually came out ahead. Not gonna quit my day job, but it was fun. Click here to visit: 160bet
Brazino777Cancion seems legit. They’ve got a decent selection of games and seem reliable. Give them a shot: brazino777cancion
VN123vip? Nghe cái tên là thấy sang xịn mịn rồi đó. Không biết chất lượng thế nào, nhưng mà cứ vào thử xem sao. Biết đâu lại vớ được món hời. Let’s go vn123vip!
One7899vn is worth a shout for their VIP program. If you’re a high roller, the perks are actually pretty good. Definitely makes a difference on your ROI. Just sayin’: one7899vn
Looking for a quick and easy casino login? BMW33login fit the bill. Simple to use and gets you straight into the action. Check it out here : bmw33login.
Thank you for sharing with us, I believe this website truly stands out : D.