Lors d’une récente déclaration, Donald Trump, ancien président des États-Unis et candidat républicain à la présidentielle de 2024, a annoncé son intention de « récupérer » la base aérienne de Bagram, en Afghanistan. Une annonce aussi surprenante que lourde de sous-entendus géopolitiques.
« L’une des raisons pour lesquelles nous voulons cette base est qu’elle se trouve à une heure de l’endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires », a-t-il déclaré, réaffirmant sa volonté d’une posture plus offensive vis-à-vis de Pékin.
La base de Bagram, située à environ 60 kilomètres de Kaboul, a longtemps été le centre névralgique des opérations militaires américaines en Afghanistan. Abandonnée dans la précipitation durant le retrait des troupes en 2021, elle symbolise encore aujourd’hui, pour beaucoup d’observateurs, la fin chaotique d’un conflit de vingt ans.
Un retour à Bagram : un projet réaliste ou rhétorique de campagne ?
La déclaration de Donald Trump soulève de nombreuses questions, à commencer par sa faisabilité. Les talibans, aujourd’hui au pouvoir à Kaboul, contrôlent pleinement la base, désormais partiellement réaffectée par le régime. Une réimplantation militaire américaine sur le sol afghan relèverait donc non seulement d’un revirement diplomatique majeur, mais également d’une opération militaire aux conséquences régionales incertaines.
Pour Anthony Cordesman, ancien conseiller du Département de la Défense et chercheur au CSIS (Center for Strategic and International Studies), « la reprise de Bagram nécessiterait soit une négociation directe avec les talibans — ce qui semble improbable — soit une action militaire directe, ce qui déclencherait une nouvelle escalade dans la région ».
Un message adressé à la Chine ?
Au-delà de la question afghane, le message de Trump vise clairement Pékin. En mettant en avant la proximité géographique de Bagram avec la province chinoise du Xinjiang — soupçonnée d’abriter plusieurs installations militaires sensibles, dont des sites de recherche nucléaire —, Trump agite la menace d’une surveillance ou d’un contrepoids stratégique aux ambitions chinoises.
Une posture qui s’inscrit dans une rhétorique de plus en plus musclée entre les deux puissances, sur fond de tensions commerciales, technologiques et militaires.
Pour Jessica Mathews, ancienne présidente de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, « cette déclaration s’inscrit dans une tradition trumpienne d’attaques frontales contre la Chine, mais elle soulève aussi des inquiétudes sur l’usage d’une logique militaire pour des enjeux avant tout diplomatiques ».
L’ombre du retrait de 2021
Le retour potentiel à Bagram ravive aussi les blessures encore vives du retrait américain d’Afghanistan. La manière dont les forces américaines ont quitté la base, de nuit, sans prévenir leurs partenaires afghans, avait été largement critiquée, y compris aux États-Unis. Trump, bien qu’ayant initié le processus de retrait en 2020 via l’accord de Doha, critique ouvertement la gestion de l’évacuation par l’administration Biden.
Son discours s’adresse ainsi autant à ses électeurs qu’à la communauté internationale : il entend restaurer une image de fermeté et de contrôle, contrastant avec ce qu’il qualifie de « déroute humiliante » orchestrée par ses successeurs.
Une stratégie d’influence ou de dissuasion ?
Le positionnement de Bagram en Asie centrale n’a jamais été anodin. Véritable poste avancé, la base permettait non seulement de surveiller les mouvements en Afghanistan et au Pakistan, mais aussi d’observer les frontières chinoises, iraniennes et même russes. Son éventuelle réactivation ne serait pas qu’un symbole : ce serait un signal stratégique fort.
Mais pour nombre d’experts militaires, il ne s’agit pas tant d’une annonce concrète que d’un outil rhétorique destiné à galvaniser une base électorale sensible aux enjeux de sécurité nationale.
Conclusion : entre ambition stratégique et discours de campagne
En proposant de « reprendre » Bagram, Donald Trump ne se contente pas d’un effet d’annonce : il réactive une mémoire géopolitique forte, entre nostalgie d’une domination américaine incontestée et promesse de fermeté face aux puissances rivales. Mais derrière les mots, la réalité du terrain et les équilibres diplomatiques actuels rendent un tel projet extrêmement incertain.
Reste à savoir si cette promesse s’inscrira dans une véritable doctrine stratégique, ou si elle ne sera qu’un élément de plus dans une campagne électorale où la politique étrangère redevient un terrain de combat.


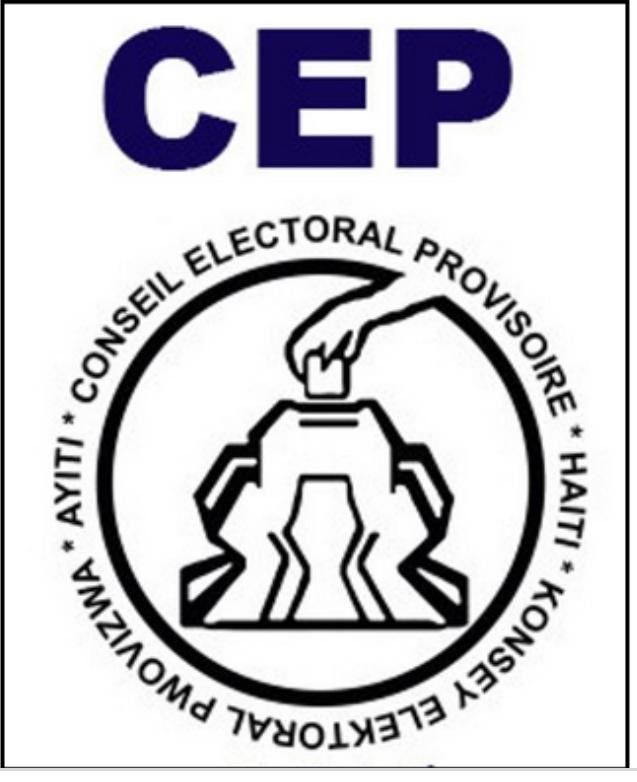


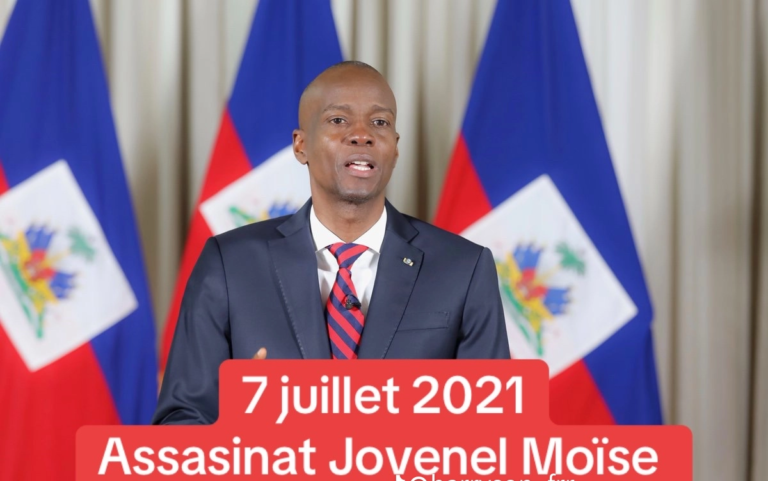
This is pure gold. Thank you for sharing your expertise.
Alright, so OKVIP78win isn’t bad. It’s got a pretty standard casino layout, but some of the games are a bit more unique. Not a huge fan of the color scheme, but that’s just me. Check it out for yourself okvip78win.
Boin888… Hmm, not bad, not bad at all. I found some interesting niche games that I hadn’t seen elsewhere. Payouts were smooth, no hassle. Worth a look if you’re bored with the usual. boin888
JLJL99AppLogin, I see you! Honestly, sometimes logging in is the biggest hurdle. This app seems to streamline that process, which is a huge win in my book. Makes gaming so much faster and more enjoyable. Try it: jljl99applogin
F9game is my new go-to! Loads of different games to try, and the platform is user-friendly. Give them a try!. All the fun starts f9game.
23winslot? Name kinda speaks for itself, right? Slots galore! Some of them are surprisingly fun, and payouts aren’t terrible. Worth a spin or two, I reckon. More info here: 23winslot
Alright, gotta give a shoutout to ZALVCOM! Their site loads super fast, and the games are seriously addictive. Give zalvcom a go. You’ll be hooked in no time!
Hey, I’ve been checking out dito777app and it’s pretty solid. Easy to navigate and seems like a good time. Check it out yourself at dito777app!