À grands renforts de fanfares, de tentes officielles et de discours pompeux, l’État haïtien a déboursé plus de 100 millions de gourdes — soit environ 700 millions de dollars américains selon les sources officielles — pour marquer en grande pompe le 234e anniversaire de la célèbre cérémonie de Bwa Kayiman, que certains historiens eux-mêmes qualifient encore de légendaire ou symbolique, faute de preuves irréfutables.
La cérémonie, tenue au Cap, a rassemblé ministres, officiels, artistes, groupes folkloriques, drapeaux, tambours, et toute une mise en scène censée raviver l’âme de la révolution haïtienne. Mais pendant ce temps, la ville elle-même offrait un tout autre spectacle : celui de la misère ordinaire, de la saleté omniprésente, des ordures dans les canaux, et des routes défoncées.
Une célébration, mais à quel prix ?
La dépense, révélée dans un rapport budgétaire partiel du ministère de la Culture, a suscité une vague d’indignation parmi la population locale. Pour beaucoup, il s’agit moins d’un hommage historique que d’un gaspillage institutionnalisé, alors que le pays traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire moderne : insécurité généralisée, crise sanitaire, système éducatif en lambeaux, services publics quasi inexistants.
« Bwa Kayiman ne nous donne ni eau, ni électricité, ni écoles. On nous parle de révolution, mais on vit dans la crasse », confie un habitant du centre-ville de Cap-Haïtien, montrant du doigt un tas d’immondices au pied d’une école publique fermée depuis des mois.
Entre mythe et manipulation historique
Si Bwa Kayiman est inscrit dans la mémoire nationale comme un moment fondateur de la révolution haïtienne, son existence factuelle est encore débattue. Certains historiens évoquent un récit surtout construit au XIXe siècle pour forger une mythologie révolutionnaire, un symbole mobilisateur plus qu’un fait historique documenté.
Mais au-delà du débat académique, une question s’impose : doit-on engager autant de ressources pour célébrer un événement dont la véracité est encore sujette à controverse, alors que les besoins de la population sont urgents et criants ?
Le pays réel versus le pays officiel
Ce contraste entre le faste des cérémonies et la réalité au sol n’est pas nouveau en Haïti. Depuis des décennies, les gouvernements successifs excellent dans l’art de la commémoration, des discours solennels et des symboles, pendant que les écoles ferment, les hôpitaux manquent de médicaments et les routes se transforment en rivières de boue.
Le Cap, deuxième ville du pays, est aujourd’hui dans un état lamentable. L’insalubrité y est chronique, les déchets s’amoncellent dans les rues, et de nombreux quartiers vivent sans services de base. Fêter l’histoire, oui — mais peut-on le faire en ignorant les vivants ?
Des priorités à redéfinir, d’urgence
La vraie question n’est pas de savoir s’il faut honorer nos racines, mais comment et à quel moment. Dans un pays où les enfants meurent faute de soins de base, où l’éducation est un luxe et où l’État est souvent absent là où il est le plus attendu, la priorité ne peut être une cérémonie folklorique, aussi symbolique soit-elle.
L’histoire a sa place. La culture est un pilier d’identité. Mais ni l’une ni l’autre ne devraient servir de rideau de fumée pour masquer l’échec à répondre aux besoins fondamentaux de la population. À moins que l’objectif réel ne soit de gouverner par la distraction, dans un pays qui souffre plus que jamais d’un manque de vision, de responsabilité, et surtout, de respect pour la dignité humaine.
L’avenir ne se construit pas uniquement avec le passé
Nous pouvons — et devons — honorer notre histoire. Mais le vrai hommage aux héros de 1791, c’est une Haïti où les enfants mangent, apprennent, et vivent dans la dignité. Ce n’est pas dans les cérémonies, mais dans les actions concrètes que se mesure la fidélité à leur combat.

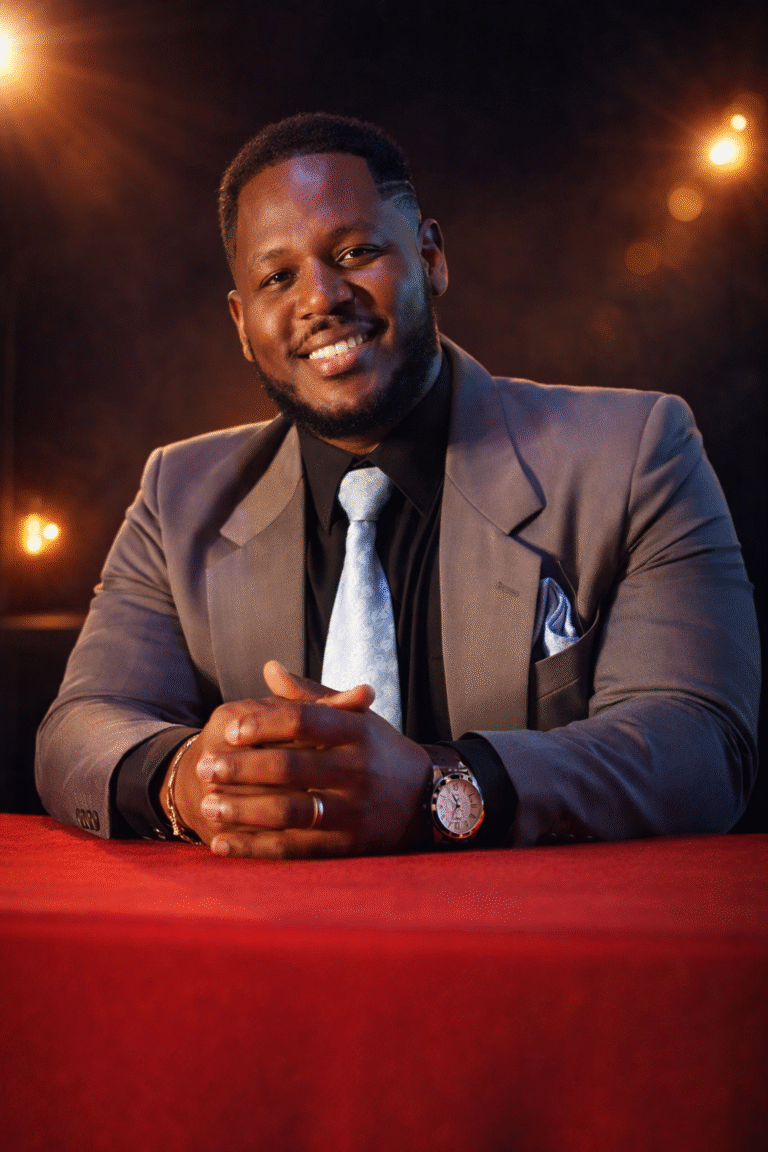

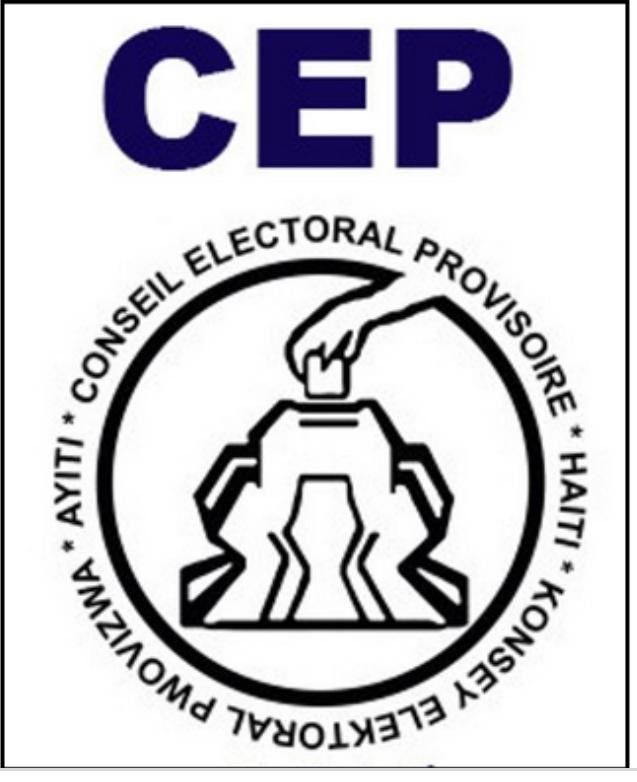


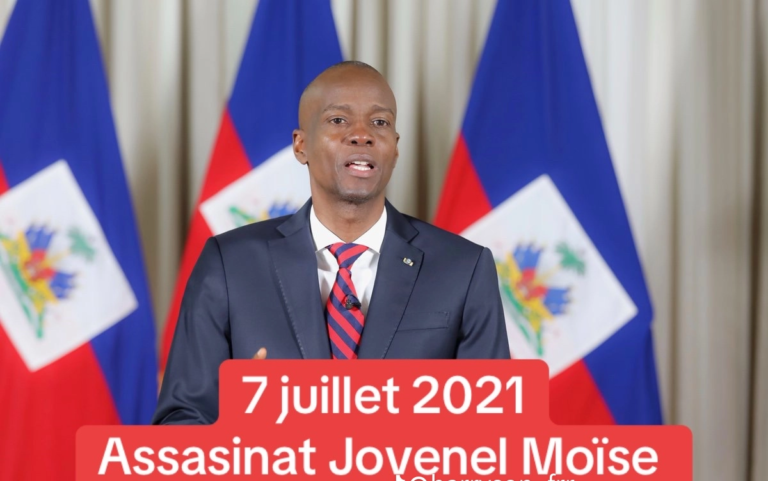
Achievement-based service, achievements visible immediately. Achievement-oriented service. Results-driven success.
Dry Cleaning in New York city by Sparkly Maid NYC
Heard some good things about mc88club and decided to check it out. Pleasantly surprised by the vibe. Smooth experience overall. You just might find your new place to play at mc88club.
Lottery Games Bet, this site is pretty slick. Wondering if anyone’s actually won big on here? Worth a shot, maybe? Check it out: lotterygamesbet
Yo, check out 7game6. Been playing there lately and it’s got some decent slots and a few live games. Nothing too crazy but solid for a casual spin. Just sayin’!
Anyone using the 8k8app11? How is it? Is it better than the website? Always on the lookout for a better mobile experience. Download the new app here: 8k8app11
Downloaded the kim88app. It’s okay and very smooth. It is very colorful and vibrant, check it out ! It is good for killing time. kim88app
Yo, downloading the 166BetApp right now. Mobile betting is everything these days! Gotta be smooth, fast, and easy to use. Hope this app delivers. Betting with 166betapp to see what the fuss is about!
Vph777login, huh? Decent enough. No crazy bells and whistles, just a straightforward platform to play on. Gets the job done. Give it a whirl – vph777login.