Une vidéo diffusée massivement sur les réseaux sociaux alimente depuis quelques jours une vive controverse dans l’espace médiatique haïtien. Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », figure notoire du paysage gangstérisé de la capitale, y accuse frontalement le journaliste Jhonny Ferdinand d’avoir reçu une somme d’argent à travers l’intermédiaire de Magalie Habitant. Une affirmation qui suscite des réactions en chaîne, dans un contexte déjà marqué par une méfiance grandissante envers les institutions, y compris les médias.
Dans cette séquence virale, Barbecue affirme que Magalie Habitant — actuellement incarcérée — aurait transmis 100 000 gourdes au journaliste Jhonny Ferdinand. Selon lui, cet argent aurait été remis à la demande de son propre groupe. Les motivations exactes de cette prétendue transaction restent floues, mais l’effet recherché semble évident : déstabiliser et décrédibiliser une voix journalistique jugée dérangeante.
Quand les gangs s’en prennent à la presse
Ce type d’accusation, en soi, n’est pas nouveau. En Haïti, les journalistes évoluent dans un environnement de plus en plus hostile, où la vérité dérange et où ceux qui la cherchent deviennent eux-mêmes des cibles. Les gangs, pris dans l’étau de leur propre mise en lumière, ont souvent recours à des stratégies de manipulation médiatique pour tenter d’inverser les rôles : salir l’image des journalistes afin de mieux s’en protéger.
L’affirmation de Barbecue, sans preuve tangible, s’inscrit dans cette logique. Elle vise moins à informer qu’à instiller le doute, semer la confusion, et affaiblir la crédibilité d’une presse déjà fragilisée par les menaces, l’intimidation, et parfois la désinformation.
Un silence qui en dit long
Interpellée par cette déclaration, Magalie Habitant, bien qu’incarcérée, n’a jusqu’ici fourni aucune réaction officielle. Son silence est interprété de diverses façons, selon les sensibilités de chacun. Sur les réseaux sociaux, les avis se divisent : certains dénoncent une cabale contre un journaliste connu pour sa rigueur, d’autres réclament des enquêtes et des éclaircissements.
Mais au-delà de cette affaire, c’est la confiance du public envers les médias qui se retrouve une fois de plus mise à l’épreuve. Dans un pays où les repères institutionnels s’effondrent les uns après les autres, la presse reste l’un des derniers contre-pouvoirs encore debout.
Lumière sur le rôle des journalistes
Il faut le redire avec force : tous les propos tenus par des chefs de gangs ne doivent pas être acceptés sans examen critique. Dans une société où le chaos devient un outil de pouvoir, la parole manipulée devient une arme.
Les journalistes, eux, ne sont pas parfaits, mais ils ont pour mission d’éclairer, de guider, de questionner — parfois au prix de leur vie. Sans eux, sans certaines rédactions tenaces et courageuses, Haïti aurait depuis longtemps basculé dans une obscurité totale.
À l’heure où les mots peuvent tuer, la vérité devient un acte de résistance. Et face aux tentatives de déstabilisation, la meilleure réponse reste le professionnalisme, la transparence, et la persévérance de ceux qui choisissent chaque jour de dire ce qui dérange, plutôt que de se taire.


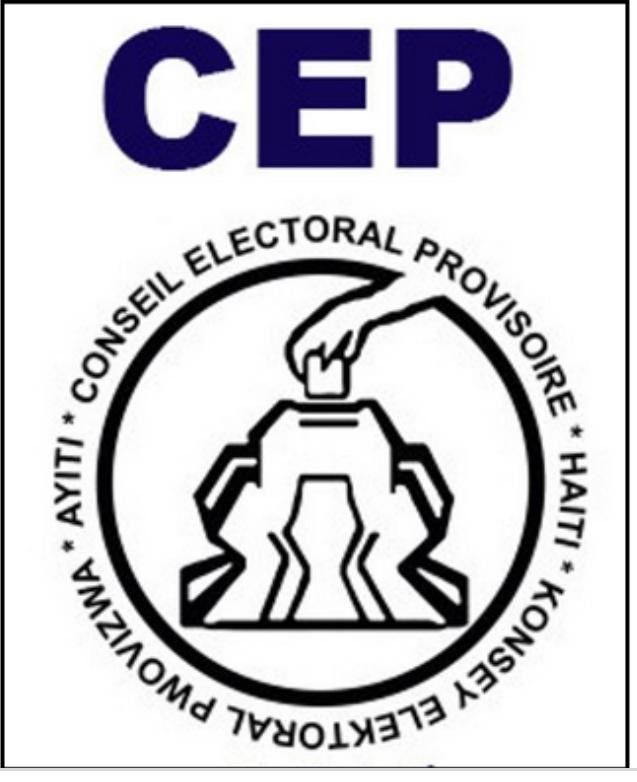


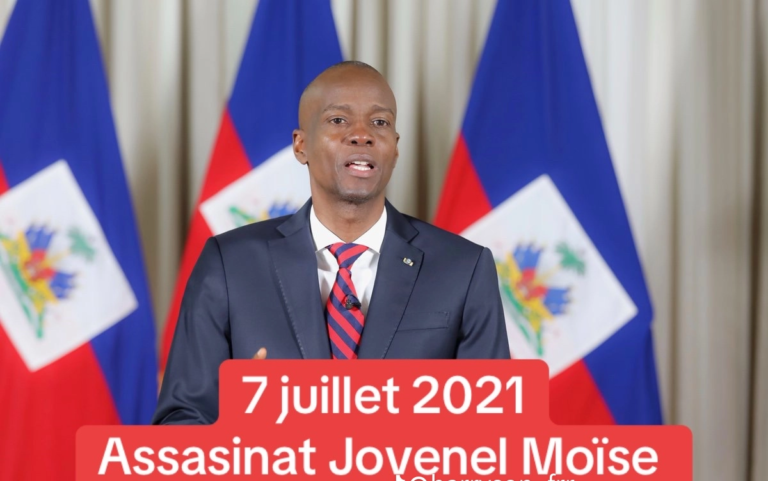
Thử truy cập https://luongsontv42.com/ trong trận Siêu kinh điển tuần rồi và phải nói là cực kỳ ấn tượng. Dù lượng người xem rất lớn nhưng không hề bị lag. Web còn có cả lịch thi đấu và highlight nên tiện theo dõi thông tin. Mình đã lưu lại để xem thường xuyên hơn.
Lúc đầu mình khá nghi ngờ vì sợ bị quảng cáo làm phiền, nhưng khi vào Lương Sơn TV thì khác hẳn mong đợi. Link mở nhanh, không cần cài đặt hay đăng nhập gì cả. Dù lần đầu thử đã xem trọn vẹn cả trận không gặp lỗi. Nên mình quyết định lưu trang lại dùng dài lâu.
I have learn several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you put to create this type of magnificent informative site.
Downloaded the jili16app the other day. Pretty slick! Runs smoothly on my phone, which is a huge plus. Get yours at jili16app and let me know what you think.
69vn15bet… alright, alright. The name is…interesting. Hoping the site is just as interesting in a *good* way. Time to dive in and see if the games are any fun. Fingers crossed! Vamanos! Check it out here: 69vn15bet
Superlg! Let see what they’re offering and if it lives up to the name! Is it Super like the name? Visit it here: superlg
Gamvipm88, yo! It’s got some alright things going on. Check it out! gamvipm88
Dude, JLPH8 is where it’s at! Had some seriously intense gaming sessions there. Great selection of games and the community’s pretty cool too – jlph8
Man, I love watching ‘gà chọi c1’! The intensity is insane. Gotta check this site for the latest. gà chọi c1.
Yo, 66winlogin is where it’s at! Smooth login, easy to navigate, and gets you right into the action. Definitely recommend checking it out. 66winlogin
Lucky22…is today my lucky day? Probably not, but gonna check it out anyway. Link this way: lucky22
Super-Duper website! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!
You actually make it appear so easy together with your presentation however I find this topic to be really one thing which I feel I would never understand. It sort of feels too complicated and very vast for me. I’m having a look ahead in your next put up, I’ll attempt to get the dangle of it!